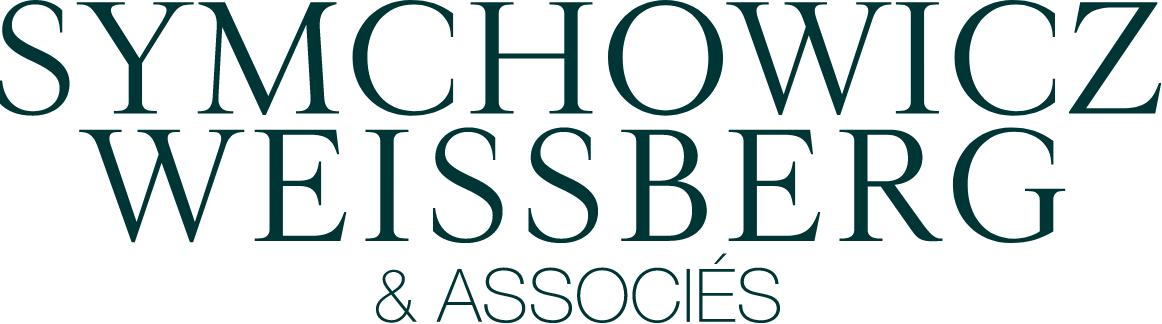Une SCI avait fait construire un garage sur un terrain dont elle avait elle-même réalisé le remblai. Elle avait confié l’établissement et le dépôt de la demande de permis de construire à un architecte tiers. Se plaignant d’un soulèvement du sol et de fissures sur le dallage, la SCI avait assigné les différents intervenants à la construction (notamment : le maître d’œuvre, l’architecte, le bureau d’étude chargé de l’étude des fondations, l’entrepreneur chargé des travaux de fondations et de la réalisation des longrines d’une partie des dallages et l’entreprise chargée d’une autre partie du dallage).
La Cour d’appel saisie du litige retenait la responsabilité décennale de l’architecte et le condamnait (in solidum avec le maître d’œuvre et le bureau d’étude) à verser la somme de 625.000 euros à la SCI et de retenir sa responsabilité à concurrence de 25 %.
Au soutien de son pourvoi, l’architecte alléguait qu’il n’était responsable que dans les limites de la mission qui lui avait été confiée et qu’en conséquence, chargé seulement d’une mission d’établissement d’un dossier de permis de construire, il n’était pas tenu de réaliser des travaux de reconnaissance des sols ni d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’en réaliser. Par ailleurs, il faisait valoir que la pose du remblai ayant provoqué les désordres était postérieure au dépôt du dossier de permis de construire, et donc à l’achèvement de sa mission.
Cette argumentation n’a pas convaincu la Cour de cassation qui a jugé le 21 novembre 2019 : « qu’ayant retenu, à bon droit, que M. A…, auteur du projet architectural et chargé d’établir les documents du permis de construire, devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol, la cour d’appel, qui a constaté que la mauvaise qualité des remblais, mis en œuvre avant son intervention, était la cause exclusive des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage, en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que M. A… engageait sa responsabilité décennale »
Il ressort donc de la mission de l’architecte en charge du dossier de permis de construire de tenir compte des contraintes du sol. Il doit donc réaliser ou prendre connaissance des études de sol nécessaires, sous peine de voir engagée sa responsabilité.