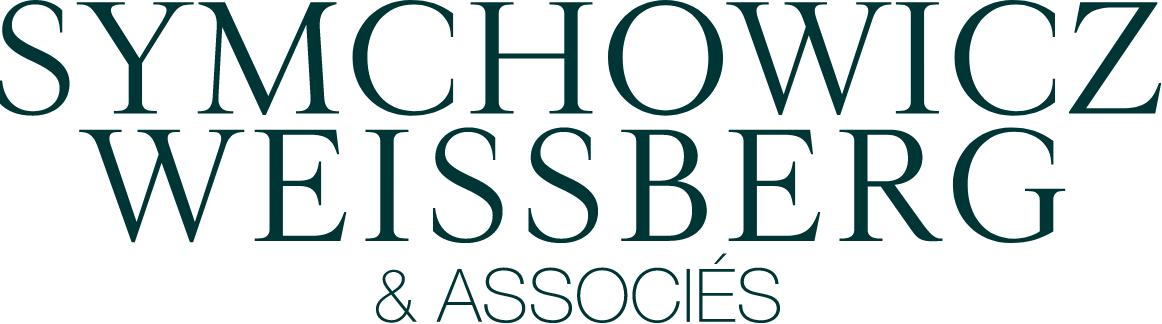Le 15 octobre dernier, la proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, telle qu’issue des travaux de la Commission Mixte Paritaire, a été définitivement adoptée au Parlement. De nombreuses évolutions de fond sont à noter, dans un objectif d’accélération des projets de logements ; ainsi que des modifications tout aussi importantes tenant à l’instruction des autorisations, au contentieux et à la police de l’urbanisme.
- Inopposabilité des règles d’urbanisme nouvelles à un permis modificatif, sauf si elles concernent la sécurité ou la salubrité publique
Le futur article L. 431-6 du code de l’urbanisme prévoit que « si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial » – sauf si ces dernières « ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques ».
La même règle est prévue pour les permis d’aménager à l’article L. 441-5 du code de l’urbanisme.
Concrètement, cela signifie que les règles d’urbanisme applicables aux permis de construire ou d’aménager modificatifs sont cristallisées et que les demandes de modifications devront être instruites au regard des règles applicables au jour de la délivrance du permis de construire initial. Bien évidemment, cela ne s’applique pas au cas où les travaux sont achevés, puisqu’il n’est alors plus question de modifier des travaux mais d’en réaliser de nouveaux.
- Possibilité de proroger la durée de validité d’un permis précaire
Lorsqu’un permis précaire a été délivré pour une durée limitée, l’autorité compétente pourra prolonger, une fois, le délai (qu’elle fixe) à l’issue duquel le pétitionnaire devra enlever la construction autorisée en application de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme.
- Renforcement des sanctions en cas de travaux illégaux
Le pouvoir de mise en demeure de mettre en conformité les constructions, créé par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique et prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, largement utilisé par les autorités compétentes en matière d’urbanisme, est renforcé.
Premièrement, l’autorité compétente en matière d’urbanisme pourra désormais, outre son pouvoir de mise en demeure de mise en conformité ou de dépôt d’une demande d’autorisation visant à la régularisation des travaux illégaux, infliger une amende d’un montant maximal de 30 000 euros – à titre alternatif ou cumulatif.
Il est à noter que cette amende peut aussi être prononcée lorsque l’intéressé n’a pas satisfait dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure.
Deuxièmement, le montant des astreintes est considérablement augmenté : 1 000 euros par jour, dans la limite d’un total de 100 000 euros d’astreinte – au lieu de 500 euros par jour et 25 000 euros maximum.
Surtout, le contrevenant sera obligé de s’acquitter des sommes dues, puisque l’opposition à l’état exécutoire pris pour recouvrer l’amende ou l’astreinte n’aura pas de caractère suspensif.
Troisièmement, le préfet pourra, par arrêté motivé, se substituer à l’autorité compétente (en pratique, le maire), après l’avoir invitée à exercer lesdits pouvoirs et en l’absence de réponse de sa part.
Quatrièmement, l’autorité compétente pourra mettre en œuvre d’office les mesures ordonnées par la mise en demeure, non seulement en présence d’un risque certain pour la sécurité ou la santé mais, également, lorsque les travaux entrepris ou exécutés « se situent hors zones urbaines » – la démolition devant toujours être autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
- Nécessité de participer à l’enquête publique ou à la PPVE pour pouvoir attaquer un document d’urbanisme
Le nouvel article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme prévoit désormais que les personnes physiques ou morales ne seront recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme que si elles ont préalablement participé à l’enquête publique ou à la procédure de participation par voie électronique.
Selon le législateur, il s’agit, à titre principal, de prévenir l’usage purement dilatoire des recours, au profit d’une évaluation en amont de l’acceptabilité du document, afin d’éviter qu’« en dépit des efforts de concertation déployés par la collectivité, un requérant qui n’aurait pas participé aux discussions préalables puisse après l’adoption du document le remettre en cause, alors qu’il n’est plus possible pour la commune ou l’établissement de tenir compte d’observations ce qui aurait pu permettre d’éviter l’engagement d’un contentieux et, parfois, l’annulation du document ». Cela ne s’applique pas à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
Les travaux parlementaires laissent entendre, dans le cadre de la discussion en commission mixte paritaire, que si une personne prouve qu’elle n’a pas été en mesure de participer à la consultation publique – par exemple parce qu’elle a emménagé dans la ville en cause après ladite consultation publique –, elle pourrait disposer d’un intérêt à agir. Il appartiendra à la jurisprudence administrative de le confirmer et le préciser.
Ces dispositions seront applicables lorsque la participation du public a été engagée plus d’un mois après la promulgation de la présente loi.
- Cristallisation des moyens de substitution dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours
L’article L. 600-2 du code de l’urbanisme énonce désormais que « lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et refusant l’occupation ou l’utilisation du sol ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
Cette disposition, très importante, vise donc tant les refus et retraits d’autorisation d’urbanisme que, selon nous, les sursis à statuer sur les demandes d’autorisations ; ainsi que les décisions juridictionnelles relatives à de telles décisions.
En pratique, les collectivités compétentes devront donc être extrêmement réactives dès la notification d’un recours contentieux dirigé contre un refus d’autorisation et reprendre immédiatement le dossier du pétitionnaire pour voir si d’autres motifs de refus devraient être ajoutés ou substitués ; si c’est le cas, elles devront produire des écritures contentieuses en ce sens dans un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours.
Ces dispositions entreront en vigueur pour tous les recours enregistrés par la juridiction administrative après la publication de la présente loi.
- Présomption d’urgence pour les référés formés contre un refus d’autorisation d’urbanisme
L’article L. 600-3 du code de l’urbanisme disposera désormais que pour tout référé-suspension introduit contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
Ces dispositions seront applicables aux référés introduits après la publication de la présente loi.
- Délai d’un mois pour introduire un recours gracieux, qui ne proroge pas le délai de recours
Il s’agit là d’une modification très importante, nouveau « chausse-trappe » procédural et qui, en pratique, aura pour effet d’obliger les requérants à former directement un recours contentieux – possiblement à rebours de l’objectif poursuivi.
En effet, le nouvel article L. 600-2 du code de l’urbanisme dispose désormais que :
« Le délai d’introduction d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique à l’encontre d’une décision relative à une autorisation d’urbanisme est d’un mois. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Le délai de recours contentieux contre une décision mentionnée au premier alinéa n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique. ».
Ces dispositions entreront en vigueur au jour de la promulgation de la loi.