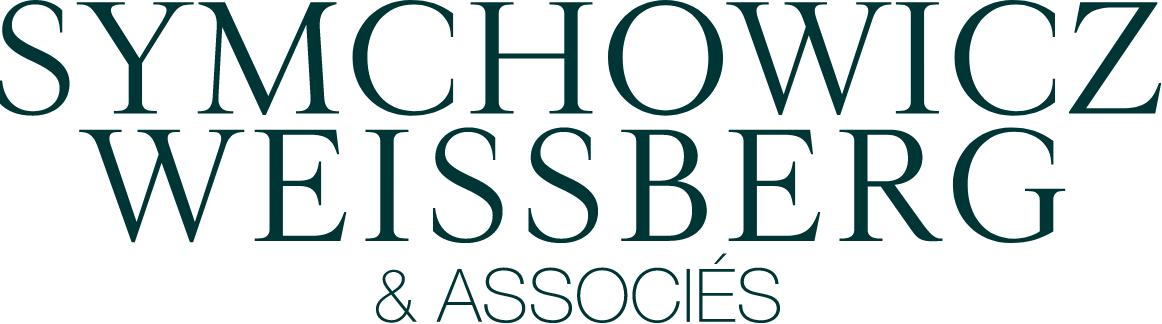Par une décision en date du 7 septembre 2017, la Cour européenne des droits de l’homme juge contraire à la liberté d’expression, protégée par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme (CESDH), la condamnation pénale d’un élu local qui, lors d’une séance du conseil municipal, avait accusé d’escroquerie dans la passation d’un marché public le maire et sa première adjointe.
S’agissant du contexte, Monsieur Lacroix, qui était – en sa qualité de membre des commissions des finances et des appels d’offres – en charge du suivi d’une opération de sécurisation et d’aménagement du domaine public, a dénoncé au cours de l’année 2009 des irrégularités qui affectaient selon lui deux marchés publics relatifs à cette opération. Celui-ci adressa un courrier au préfet des Alpes-Maritimes et à la chambre régionale des comptes à ce sujet et, lors d’une séance du conseil municipal, accusa le maire ainsi que sa première adjointe d’escroquerie et demanda leur démission ce qui fut ensuite rapporté par le quotidien Nice Matin. Ces accusations avaient conduit à l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République concernant les modalités du marché public critiqué par le requérant lequel s’était vu adresser par l’élu un courriel contenant de nombreuses pièces visant à dénoncer les agissements que ce dernier jugeait délictueux. C’est ainsi que l’élu local et le directeur de la publication de Nice Matin ont été cités en diffamation publique devant le tribunal correctionnel de Grasse. Si le directeur de la publication de Nice Matin a été relaxé, l’élu local a quant à lui été déclaré coupable du délit de diffamation publique, au motif qu’il n’avait pas établi la réalité des faits dénoncés et donc condamné à payer une amende de 1 000 euros ainsi qu’à verser à chacune des parties civiles un euro au titre de dommages-intérêts. Saisie de cette affaire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré l’élu local déchu du droit de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires et lui a refusé le bénéfice de la bonne foi, avant de confirmer le jugement de première instance. La Cour de cassation a refusé d’admettre le pourvoi du requérant.
Saisie par le requérant, la Cour européenne des droits de l’homme a censuré la position retenue par les juridictions françaises en considérant que la condamnation pénale prononcée à son encontre pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression et a, à ce titre, enfreint l’article 10 de la CESDH.
Si la Cour a rappelé qu’est légale l’ingérence à la liberté d’expression prévue par les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, celle-ci a également rappelé qu’un maire, en sa qualité de citoyen chargé d’un mandat public, « s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes [et] doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance » (CEDH, 12 avril 2012, De Lesquen du Plessis-Casso c/ France, req. n° 54216/09). Et, la Cour relève que les déclarations litigieuses relevaient du débat public et qu’elles visaient à « mettre en lumière et à informer les électeurs d’irrégularités qui, selon lui, entachaient l’exécution et la passation de marchés publics dont il était en charge ». Enfin et surtout, la Cour souligne, comme elle l’avait fait dans sa décision De Lesquen du Plessis-Casso, que « les propos du requérant constituent des invectives politiques que les élus politiques s’autorisent lors des débats, lesquels peuvent être parfois assez vifs lors des séances de conseils municipaux » et que ces propos « étaient fondés sur une base factuelle suffisante ».
Au final, dans les circonstances de l’espèce, la Cour juge, d’une part, qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre la nécessité de protéger le droit à la liberté d’expression du requérant et celle de protéger les droits et la réputation des plaignants et, d’autre part, que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne peuvent passer pour pertinents et suffisants et ne correspondent à aucun besoin social impérieux. La Cour retient donc la violation de l’article 10 de la Convention et a condamné l’État à verser au requérant, au titre de son préjudice moral, une indemnité de 5 000 euros.
CEDH, 7 septembre 2017, Lacroix contre France, req. n° 41519/12