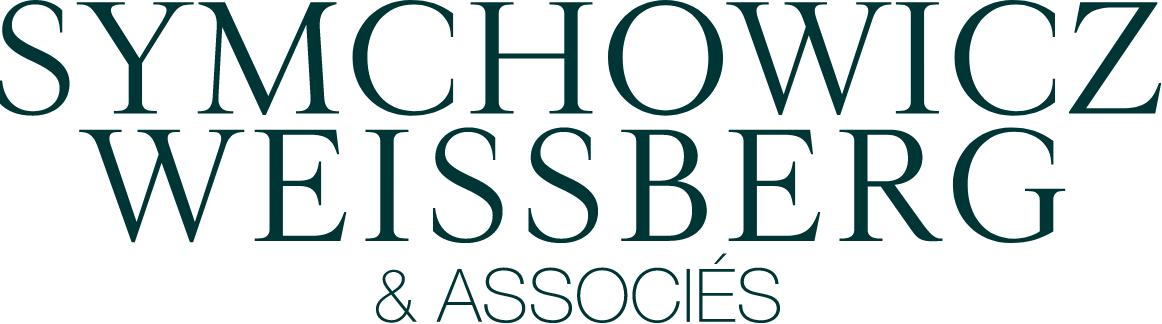Le 15 septembre 2025, la Cour des comptes a rendu public son rapport d’initiative citoyenne sur la contribution des usagers au financement des transports collectifs urbains et juge l’instauration d’une gratuité coûteuse et inefficace.
Les communes, regroupées au sein d’intercommunalités, chargées de l’organisation des transports collectifs urbains (TCU), en assurent le financement et en fixent les tarifs. Toutefois, les recettes tarifaires ne couvrent que 41 % des dépenses de fonctionnement, hors investissement, et ce ratio décroît en fonction de la taille du réseau : il atteint 45 % en Ile-de-France (IDF) mais tombe à 33 % hors IDF et à 18 % pour les autorités organisatrices des mobilités (AOM) de moins de 100 000 habitants. Ce manque de recettes tarifaires laisse le reste à la charge de la collectivité qui peut percevoir une taxe sur la masse salariale des employeurs locaux (le versement mobilité) et/ou utiliser leur budget général, financé par les contribuables locaux.
Au terme de son enquête, la Cour constate que, depuis une vingtaine d’années, les collectivités locales privilégient une politique de modération tarifaire en multipliant les tarifs spécifiques sans forcément les lier à des conditions de ressources.
Cette gratuité, quand elle a été décidée, a des conséquences variables sur l’équilibre financier des TCU. Pour les petits réseaux peu fréquentés, la gratuité totale peut relever d’une logique d’efficience de la dépense publique, dans un contexte où les bus circulent quasiment à vide et où les recettes tarifaires sont faibles : elle entraîne une hausse de fréquentation plus importante que la hausse des ressources publiques mobilisées. Mais, pour les réseaux importants déjà bien fréquentés, la gratuité entraîne des pertes de recettes significatives et nécessite de développer l’offre de service pour accueillir l’afflux de voyageurs supplémentaires. Les tensions financières qui en résultent menacent par ailleurs les projets d’investissement nécessaires pour le verdissement des bus et le développement du réseau.
Selon la Cour, le prix ne constitue pas un frein à l’usage des transports en commun, excepté pour les usagers les plus défavorisés, et si la gratuité augmente la fréquentation, elle n’entraîne pas toujours un report modal suffisant depuis la voiture. A Montpellier, par exemple, la gratuité a surtout permis d’attirer des personnes qui se déplaçaient à pied ou à vélo, et la hausse de fréquentation a conduit à saturer davantage un réseau déjà très fréquenté.
Ainsi, la Cour conclut que, plutôt que de développer la gratuité, il est préférable de mettre en place des dispositifs en faveur des personnes les plus vulnérables et de ne pas exclure une tarification à l’usage, différenciée dans l’espace et éventuellement dans le temps (heures creuses/pleines, pics de pollution). Il convient aussi d’accroître la lutte contre la fraude, en fixant des objectifs contraignants de moyens et de résultats aux opérateurs.